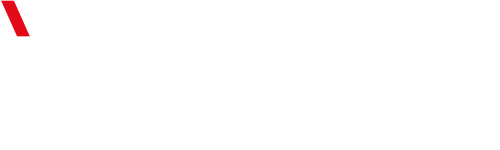« Les équipes spécialistes de l’incendie et de la qualité de l’air de l’Ineris ont réalisé une simulation de la dispersion dans l’air du panache de fumées de l’incendie de Notre-Dame, et des dépôts de monoxyde de plomb qui ont pu retomber en surface », explique l’Ineris dans un nouveau rapport. Une simulation qui a permis d’estimer la répartition géographique des dépôts de plomb, dans un périmètre d’1 à 50 km de distance du foyer d’incendie. A noter que cette estimation ne prend pas en compte les émissions de plomb au niveau du sol lors de l’effondrement des parties de la cathédrale.
PUBLICITÉ
Des concentrations détectées jusqu’à Limay
« Le profil granulométrique des particules étant un paramètre particulièrement sensible vis-à-vis des phénomènes de dépôts atmosphériques, en l’absence de données permettant de qualifier correctement ce paramètre, trois scénarios correspondant à trois hypothèses sur la répartition granulométrique des particules ont été établis », indique le rapport : trois hypothèses de répartition des particules dans des classes de granulométrie variant de 1,5 à 50 microns. Les particules les plus grosses retombant plus, et plus près de la source de l’incendie, alors que celles de plus petite taille sont déposées plus loin. « C’est ainsi qu’il est tout à fait plausible, selon les simulations que le signal en concentrations en plomb détecté par la station Airparif de Limay à 50km au Nord-ouest de Paris soit bien imputable à l’incendie de Notre Dame », estime l’Ineris.
Cependant la valeur de concentration mesurée pour la semaine du 15 au 22 avril 2019 est largement inférieure aux seuils de la valeur limite de la réglementation européenne. « Il est également important de noter qu’à cette distance, quel que soit le scenario, les dépôts sont certainement relativement faibles, de 20 à 40 fois inférieurs à ceux estimés dans le VIIème arrondissement où se situe le maximum de retombées », est-il précisé.
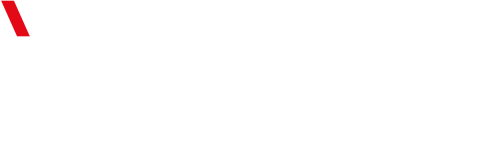














![[Tribune] Former au tri dans le BTP : méthode, timing et terrain avant tout](/e-docs/00/02/57/F7/tribune-former-tri-dans-btp-methode-timing-terrain-avant-tout_620x350.jpg)