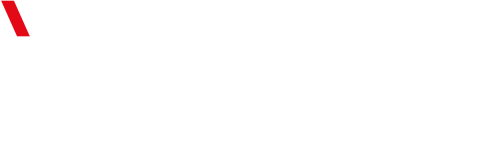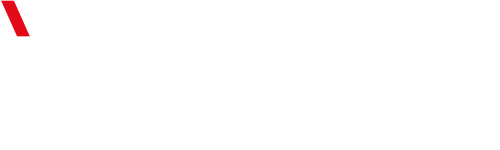Depuis août 2017, un échafaudage Layher enveloppe la Chapelle royale du château de Versailles. Une structure de plus de 45 m de haut, qui soutient un parapluie de 25 m de portée. Au total, 4 700 m² praticables ont été installés au plus près de l’édifice, pour un poids total de 400 tonnes, soit environ 50 000 pièces. Une tâche de longue haleine qui a employé de 12 à 15 compagnons sur 6 500 h entre août 2017 et janvier 2018.
PUBLICITÉ
La contrainte principale pour cette structure : elle ne doit en aucun cas s’appuyer sur la toiture de la chapelle. Ainsi, les planchers d’approche pour la couverture sont suspendus à une poutre “light weight” reconstituée. L’implantation de l’ensemble de l’échafaudage a dû également s’adapter minutieusement à de fortes variations de niveaux, le sol n’étant pas à la même hauteur sur les différents côtés de la chapelle, avec les jardins d’un côté, la cour d’honneur et la cour basse de l’autre. Les 1 500 m² de parapluie ont été préassemblés en 14 composants et hissés à l’aide d’une grue à tour (Liebherr MK 110) en une journée. Enfin, véritable innovation de cet échafaudage, un pont roulant d’une tonne a été intégré au sein du parapluie, au-dessus du faîtage, afin de permettre le démontage des éléments décoratifs du toit.
Des métiers exceptionnels
La Chapelle royale est un chef d’œuvre qui nous est resté tel qu’il a été construit, entre 1699 et 1710, à l’exception d’un lanternon retiré moins de 50 ans après son édification. Conçue par le premier architecte du roi Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart, elle allie une verticalité d’inspiration gothique à une abondance baroque de décors à la fois sculptés, dorés et peints. Une hétérogénéité dont la restauration nécessite “l’engagement de tous les métiers et savoir-faire des équipes du château de Versailles” a souligné Catherine Pégard, présidente de l’établissement public du domaine et du château de Versailles. Car ce sont plus de 3000 m² de façade, 1 015 m² de charpente et 1794 panneaux (dont 665 glaces) qui vont être restaurés durant les 3 ans à venir. Vont être mis à contribution les talents de maîtres charpentiers, maîtres couvreurs, maîtres verriers, mais aussi de serruriers, vitriers, tailleurs de pierre, doreurs, sculpteurs ou encore métalliers... Ainsi le chantier est l’occasion de valoriser ces métiers d’art, et d’en faciliter l’enseignement aux apprentis. Un souci de transmission qui anime la Fondation Philantropia, mécène et partenaire du château de Versailles depuis 2012. La fondation a déjà œuvré à la restauration des parterres et du bassin de Latone, entre 2013 et 2015.
Les travaux à venir, de haut en bas
Concrètement, les travaux démarreront avec la dépose de la couverture, des plombs et des groupes sculptés qui ornent le faîte du toit de la chapelle. L’accès ainsi ouvert sur la charpente va en permettre la restauration. Plusieurs fuites l’ont dégradée, occasionnant un affaissement important de l’angle sud-est. L’opération s’attelera également à rectifier certains renforts mal placés lors d’une précédente intervention en 1937, et à installer des passerelles d’entretiens en bois.
Un toit remis à neuf
Le toit comprend de nombreux points d’intervention : la couverture d’ardoise, vétuste, n’assure plus l’étanchéité du bâtiment, elle va donc être intégralement remplacée par des ardoises d’Espagne, posées au clou. Les plombs décoratifs, à l’origine dorés, ont subi avec le temps différents phénomènes d’oxydations altérant leur teinte. Soudées à leur support depuis les années 70, les dilatations thermiques associées à ces contraintes ont créé des fissures à leur base. Les groupes sculptés, également en plomb, comprennent principalement 2 ensembles de 3 anges posés aux extrémités du comble. Eux aussi ont perdu leur dorure, et présentent des fissures et ouvertures ponctuelles des assemblages. Le groupe occidental menaçant de se détacher, il était urgent d’intervenir. Plombs décoratifs et ensemble sculptés vont donc être démontés, restaurés en atelier et dorés à la feuille. Leur fixation sera revue en conservant autant que possible les supports d’origine, mais en évitant les soudures structurelles.
Une façade conservée et nettoyée
Les façades, dont le toit se fait l’écho en terme de faste décoratif, comprennent différent cycles de sculptures. Le décor monumental qui couronne la balustrade et le fronton, se compose de trente statues, tandis que la façade présente de nombreux bas-reliefs, frises, et ornementations végétales autour des fenêtres. Leur conservation a été retenue, et l’intervention comprendra un nettoyage et un traitement biocide, tandis que les remplacements de pierres se limiteront au strict nécessaire. Les tirants de maintien des statues de la balustrade et leur support seront révisés. Sur les bas-reliefs, en état de conservation critique, les blocs illisibles seront remplacés. Les travaux s’appuient sur une nouvelle campagne de mécénat, permettant “d’adopter” une statue, moyennant une donation de 10 000 €.
Le cas des vitraux : Saint Gobain
Protégés de l’extérieur avant l’installation de l’échafaudage, les vitraux de la Chapelle royale ne sont pas communs. Leur histoire est étroitement liée à celle du groupe Saint Gobain, à l’origine Manufacture royale des glaces. Créée en 1665 par Louis XIV et Colbert pour contrer la concurrence vénitienne, la Manufacture se voit octroyer la galerie des Glaces pour sa première commande d’envergure. C’est encore aujourd’hui sa réalisation la plus célèbre. La taille modeste des miroirs produits résulte de la technique de conception alors utilisée : le soufflage. Mais lorsque Jules Hardouin-Mansart met à contribution la Manufacture, 20 ans plus tard, pour fournir à la chapelle de la glace épaisse et transparente, un nouveau procédé a fait son apparition. La glace n’est plus soufflée, mais coulée sur table, avant d’être laminé par un rouleau. Une technique révolutionnaire qui permet des dimensions bien plus importantes et une régularité du verre sans commune mesure.
Le cas des vitraux : la restauration
Ces vitraux, encadrés de bordures peintes (rehaussés d’émaux et de jaune d’argent), sont tenus par une ossature métallique dotée d’ouvrants. Le soin apporté au système en fait une véritable menuiserie de métal. Mais le tout a subi les assauts du temps et présentent de la corrosion ainsi qu’une fragilité au niveau des émaux. Les armatures vont donc recevoir un traitement anticorrosion, tandis que les glaces vont être démontées et restaurées en atelier. Si les altérations chimiques sont limités à une simple irisation du verre, les coulures de pluie et marquent de rouilles vont être nettoyées. Sur les bordures peintes, qui ont déjà fait l’objet de réparations successives, l’émail sera refixé, et certaines parties remises en plomb. La dorure des armatures métallique achèvera la restauration de cet ensemble exceptionnel, en lui rendant sa splendeur d’origine.
Les travaux ont été répartis en deux tranches distinctes. La première tranche, qui comprend les restaurations de la charpente, de la couverture, des groupes sculptés et la dorure finale des ornements, doit s’achever fin 2019. La seconde tranche concernera la partie basse de la chapelle, les décors sculptés et les vitraux. Le budget total investi s’élève à 16 millions d’euros.