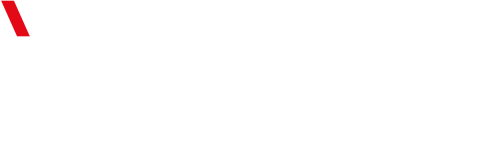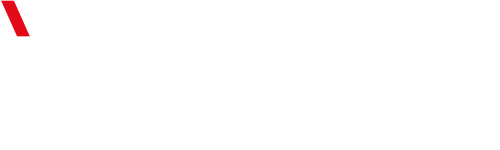En cas de dissimulation d’une partie du prix de vente d’un immeuble, la jurisprudence, de manière constante, annule la contre-lettre et impose la restitution du dessous-de-table, tout en maintenant l’acte ostensible de vente de l’immeuble (1).
Cette jurisprudence, qui valide l’action d’un acquéreur de mauvaise foi qui remet en cause l’accord conclu avec le vendeur, est donc une incitation à l’immoralité puisqu’un acquéreur peut ainsi récupérer la fraction du prix dissimulé tout en acquérant le bien pour la seule fraction du prix révélé (I).
Peut-être existe-t-il cependant une argumentation juridique permettant aux juges, qui ne font qu’appliquer les dispositions d’ordre public de l’article 1321-1 du Code civil, de remettre un peu de moralité dans ces ventes avec dessous-de-table (II).
I. La nullité de l’acte dissimulant une partie du prix de vente de l’immeuble : une prime à l’immoralité
Comme l’illustre l’arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 17 décembre 2009, excellemment commenté dans la Semaine Juridique du 22 mars 2010, en matière de vente d’immeuble avec dissimulation d’une partie du prix de vente, la jurisprudence, de manière constante :
- annule la contre-lettre,
- oblige le vendeur à restituer la partie du prix dissimulé à l’acquéreur, et,
- valide l’acte ostensible.
Cette décision, qui s’inscrit dans la jurisprudence établie depuis plusieurs années en la matière(2) fait une application stricte de l’article 1321-1 du Code Civil (anciennement l’article 1840 CGI).
Aussi, depuis de nombreuses années, les acquéreurs dissimulant une partie du prix de vente de l’immeuble, afin d’éviter une taxation au regard du droit de mutation sur cette partie du prix de vente, n’hésitent pas, en violation même de l’accord trouvé avec le vendeur, à saisir les tribunaux, afin d’obtenir le remboursement de la partie du prix dissimulé.
La jurisprudence ayant estimé que les vendeurs ne pouvant invoquer la régle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans"(3) ces derniers sont tenus de restituer la fraction dissimulée du prix mais ne peuvent récupérer l’immeuble.
L’article 1321-1 accorde donc une prime - égale à la fraction du prix dissimulée diminuée éventuellement des droits et pénalités - à l’immoralité.
En effet, alors même que l’acquéreur fait aussi preuve d’immoralité en dissimulant une partie du prix de vente et en remettant en cause l’accord trouvé avec le vendeur, ce dernier ne peut faire annuler la vente, la jurisprudence ayant jugé que "la nullité édictée par l’article 1840 du CGI à l’égard de toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix de cession de fonds de commerce, doit s’appliquer à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l’acte ostensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions"(4) .
Bien que cette jurisprudence concerne des accords qui sont contraires à la loi et que l’on pourrait considérer que le vendeur, qui a cherché à soustraire à l’impôt une partie du prix de vente, ne mérite aucune considération, force est de constater une certaine injustice dans le traitement des cocontractants également fraudeurs.
Le vendeur se trouve en effet privé de son bien pour un prix moindre que le prix convenu, alors que l’acquéreur, qui avait aussi un intérêt à dissimuler une partie du prix d’acquisition, ne serait-ce que pour réduire les droits de mutation, acquiert le bien pour un prix moindre que le prix convenu.
Il nous semble pourtant que cette injustice pourrait - et devrait - être corrigée.
II. Le droit permet-il une juste aplication de l’article 1321-1 du code civil ?
Depuis plusieurs années, les vendeurs auxquels est demandée la restitution de la fraction dissimulée du prix, tentent de s’opposer à la démarche de l’acquéreur de mauvaise foi à l’aide de deux arguments :
- l’absence de preuve de la contre-lettre,
- la nullité de l’acte ostensible de vente compte tenu de l’indivisibilité des deux conventions (acte ostensible et contre-lettre).
Comme précédemment rappelé, la jurisprudence, constante en la matière, refuse de faire droit à la demande des vendeurs, soit en refusant d’examiner l’indivisibilité des actes, soit en acceptant une exception aux règles de preuve posées par l’article 1341 du Code civil à raison de la fraude.
Il nous semble pourtant possible d’invoquer, à l’égard de l’acte ostensible, la nullité pour dol.
En effet, il convient de rappeler que l’article 1116 du Code Civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Au regard de cette définition, ne serait-il pas possible, pour le vendeur, voyant son acquéreur de mauvaise foi réclamer la restitution de la fraction du prix dissimulé, d’obtenir la nullité de l’acte ostensible sur le fondement du dol ?
Les conditions posées par l’article 1116 précité nous semblent en effet réunies.
- Il est en effet certain que l’acquéreur, en versant la fraction du prix dissimulé, a poussé le vendeur à signer l’acte ostensible, ce qui s’analyse bien en une manœuvre.
- il est tout aussi certain que si le vendeur avait eu connaissance de la volonté de l’acquéreur de remettre en cause la contre-lettre, il n’aurait pas contracté à ces conditions.
- en matière de preuve, il semble possible de soutenir que la seule action en restitution établit la volonté dolosive de l’acquéreur.
En outre, dans un heureux parallélisme des formes, l’acquéreur ne devrait pas pouvoir invoquer la règle " nemo auditur propriam turpitudinem allegans " dès lors que l’action en nullité est jugée recevable quand bien même la victime du dol aurait elle-même agi en croyant réaliser un profit substantiel non justifié(5) .
On ne pourrait ainsi reprocher au vendeur d’avoir signé l’acte ostensible en croyant réaliser un profit, notamment au regard de la fiscalité de la plus-value de cession, pour s’opposer à son action en nullité.
Bien qu’à ce jour, aucune décision ne valide cette possibilité pour le vendeur trompé par son acquéreur de mauvaise foi, de faire annuler l’acte ostensible sur le fondement du dol, il semble que les juges pourraient, constatant l’injustice résultant de l’application automatique de l’article 1341-1 du Code Civil, rétablir l’équilibre, et permettre à l’acquéreur, en appliquant, de manière aussi automatique l’article 1116 du Code Civil, de récupérer son bien.
La morale y gagnerait et la justice aussi.
André Farache, Avocat associé
Karila, société d’avocats
(1) Cass. 1e civ., 17 déc. 2009, n°08-13.276, Semaine Juridique, 22 mars 2010, Note Laurent Leveneur.
(2) Cet arrêt précise cependant qu’en cas de fraude, la dissimulation peut être prouvée par tout moyen.
(3) Douai, 8 juillet 1992, JCP N1993, 2 245, Note Lemaire.
(4) Cass. ch. mixte, 12 juin 1981, Bull. civ. V, R, p. 39.
(5) Civ. 1ère, 22 juin 2004, Bull. civ. I, n°182.