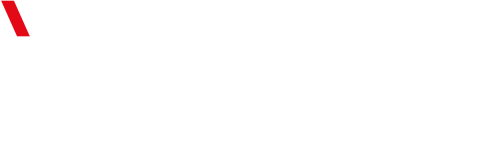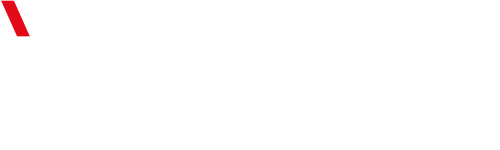Les troubles musculosquelettiques (TMS) s’expliquent par un modèle biopsychosocial, où interagissent caractéristiques intrinsèques des travailleurs (forme physique, fatigue, santé mentale) et contraintes spécifiques de leur pratique professionnelle. Une bonne condition physique protège contre ces risques, mais un état de fragilité, caractérisé par une faiblesse musculaire, une fatigue chronique ou une anxiété, peut engendrer un cercle vicieux aggravant les TMS. La pratique régulière d’activité physique apparaît comme une stratégie clé pour les réduire grâce à ses effets bénéfiques sur la forme physique, la santé mentale et sociale. Dans ce cadre, les habitudes, croyances et connaissances acquises durant l’adolescence, période clé de l’apprentissage, jouent un rôle central.
PUBLICITÉ
3 306 apprentis ont participé à l’étude, dont la moitié préparant un CAP (54,5 %) et répartis dans huit régions, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (29 %), Occitanie (24,3 %) et Poitou-Charentes (15,6 %). Les apprentis faisant partie de l’échantillon étaient majoritairement masculins (95,3 %), avec un âge moyen de 18,5 ans et un IMC moyen de 22,7, correspondant à une corpulence « normale ». Les formations aux métiers de l’énergie étaient les plus représentées (38,1 %), mais la maçonnerie (16,5 %) était le métier le plus représenté au sein de la filière gros œuvre, qui constitue le second effectif d’apprentis le plus important en formation (19,2 %).
Le maintien de la position debout, premier facteur de risque physique professionnel
Les positions debout prolongées, les postures agenouillées, les torsions des poignets et la manipulation d’objets légers (≤4 kg) ont été identifiées comme principaux facteurs de risque accru de TMS pour les apprentis, exposés à un niveau d’activité physique professionnelle certain, avec des efforts demandant surtout de l’endurance musculaire, pour des maintiens de position et des tâches de préhension répétitives. L’étude par groupe métier montre que les métiers du gros œuvre est davantage sujet à des efforts demandant de la force au travers de ports de charges réguliers, les métiers du second œuvre et de l’énergie demandent majoritairement de l’endurance musculaire et de la mobilité articulaire pour des maintiens de positions contraignantes, les métiers du bois et de la couverture demandent avant tout de la force et de l’endurance des membres supérieurs pour répondre à des tâches de préhension majoritaires et les métiers des travaux publics demandent des qualités physiques diverses au vu de l’hétérogénéité de ses tâches.
Activités physiques et sportives : 68 % des apprentis répondent aux recommandations de l’OMS
Une proportion de 68 % des apprentis du BTP interrogés a rapporté un niveau d’activités physiques en ligne avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; des résultats contraires aux chiffres attendus au lancement de l’étude. Concernant les activités sportives, 31,6 % des apprentis interrogés ont rapporté n’avoir pratiqué aucune activité sportive dans les six derniers mois. Pour le reste des apprentis interrogés, 38,9 % pratiquent une seule discipline sportive, pour 29,5 % d’entre eux pratiquant plus d’une discipline. La fréquence moyenne de pratique sportive hebdomadaire est de 4,8 fois par semaine, avec des proportions majoritaires des apprentis du BTP interrogés pratiquant deux à trois fois par semaine (respectivement 16,5 % et 18,8 %). Une durée moyenne de 2 heure 08 minutes par séance de pratique a été rapportée. Parmi les sports les plus pratiqués, citons le football (21,3 %), la musculation (12,6 %) et la course à pied (5,3 %).
Santé physique : la majorité des apprentis déclarent des niveaux de santé discutables
L’évaluation de la forme physique globale des participants à l’étude s’est effectuée à l’aide du questionnaire « International Fitness Scale » (IFIS). Malgré une pratique sportive conséquente et un niveau d’activité physique global répondant aux recommandations de l’OMS, une majorité des apprentis déclarent des niveaux de santé discutables, accompagnés d’une mauvaise forme physique (pour trois apprentis sur quatre) et de douleurs corporelles conséquentes (pour plus de 80 %). En plus d’une mise en lumière de constats alertant, ces observations contrastent avec l’idée que l’activité physique suffirait à compenser les contraintes professionnelles exigeantes.
Les trois principales recommandations de l’étude
1 | Considérer la santé mentale comme l’un des facteurs majeur déterminant la santé physique : l’apprentissage se déroule majoritairement pendant l’adolescence, une période de profonds bouleversements biophysiologiques, défis auxquels s’ajoutent ceux d’une entrée rapide dans le monde professionnel. Ces changements rendent crucial un accompagnement adapté. Cet accompagnement, en plus de prévenir l’apparition de troubles physiques, favoriserait l’épanouissement global des apprentis dans le milieu professionnel.
2 | Accompagner les apprentis vers une pratique d’activité physique et sportive plus efficace, pour une bonne forme physique en adéquation avec leur métier. Pour répondre au besoin d’améliorer la forme physique, la spécificité de l’intervention en activité physique devrait être un axe prioritaire pour garantir son efficience, avec un objectif d’équilibre optimal entre le temps consacré et les bénéfices induits.
3 | Vers une approche d’adaptation des capacités et de suppression des croyances nocébo : les résultats de l’étude confirment l’importance d’adopter une approche biopsychosociale pour améliorer la santé physique des apprentis et invitent à repenser l’écosystème de la prévention dans les métiers du BTP. La littérature scientifique montre qu’il n’y a pas de mouvement ou de geste intrinsèquement mauvais pour le corps, mais il y a des mauvaises préparations. La capacité d’adaptation du corps humain peut néanmoins permettre de faire face aux contraintes physiques. Cette adaptabilité représente une des stratégies clés pour prévenir les atteintes liées aux tâches professionnelles, notamment durant l’apprentissage, et pourtant sous-exploitée à ce jour.
Des résultats qui mettent en lumière la nécessité de changer de paradigme
L’étude propose de viser la création d’un environnement psychosocial débarrassé des facteurs nocébo et favoriser l’émergence de plans d’action innovants. Ces plans devraient s’inspirer des approches du sports de haut niveau, visant à apprendre aux apprentis à gérer leur état de forme comme le premier de leurs outils : avec une préparation physique spécifique à leur métier, une attention particulière à leur santé mentale, une gestion optimale de la fatigue et de la récupération, ainsi qu’un mode de vie sain. Ainsi, les apprentis seraient positionnés non seulement comme des travailleurs compétents, mais comme de véritables « champions de leur carrière », prêts à relever les défis avec adaptabilité et efficacité.