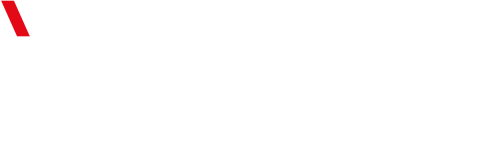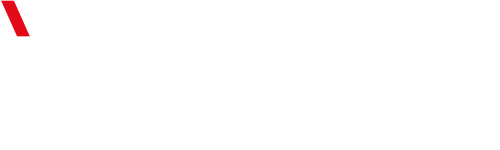Les solutions numériques peuvent aider à réduire certains impacts environnementaux, mais leurs bénéfices ne sont pas garantis et dépendent des contextes d’usage, des choix de conception et des pratiques d’accompagnement, nécessitant donc une approche au cas par cas. Bien que des bénéfices aient été observés dans les cinq cas d’analyse dans les secteurs de l’agriculture, de la mobilité, de la ville et de l’énergie, ces gains sont limités et fragiles. De plus, l’« effet rebond » pourrait annuler ces gains en incitant à une consommation accrue, entraînant ainsi des surcoûts environnementaux.
Pour le secteur de l’énergie, l’optimisation des lignes électriques à haute tension (DLR) est positive pour le climat, permettant d’éviter 43 912 tonnes de CO2 sur 16 ans et de mieux valoriser l’énergie renouvelable. Néanmoins, cette réduction ne représente que 0,36 % de l’effort total de décarbonation demandé au secteur de l’électricité d’ici 2030. Par ailleurs, cette solution engendre également des dommages environnementaux supplémentaires sur l’indicateur d’épuisement des ressources en métaux et minéraux, en raison du besoin en capteurs et équipements électroniques.
PUBLICITÉ
L’étude révèle des points de vigilance à presque toutes les solutions numériques analysées, qui peuvent fortement fragiliser, voire annuler, les bénéfices environnementaux initiaux. Le premier risque majeur est l’augmentation de la dépendance aux ressources en métaux et minéraux. Le second risque le plus critique est l’effet rebond, qui peut transformer un gain en surcoût environnemental. Ces effets rebonds sont particulièrement difficiles à quantifier. Pour l’éclairage public connecté para exemple, la prise en compte des effets rebonds indirects (réallocation des gains financiers de la ville) et d’induction (déploiement de nouveaux services "smart city" énergivores) peut inverser un bilan initialement positif en un coût environnemental net pour le climat. Il est important de souligner que la quantification de cet effet rebond est particulièrement complexe. Dans le cadre de l’étude « IT4Green », l’approche adoptée a été très conservative, faute de données disponibles permettant une quantification exhaustive. Ainsi, très peu d’effets rebonds ont été intégralement quantifiés, ce qui signifie qu’en réalité, les impacts environnementaux nets évités par ces solutions numériques sont probablement encore plus faibles que ceux présentés.
L’étude souligne qu’il est important de dépasser l’idée d’une solution numérique unique et miracle.
Le numérique peut être un allié s’il est utilisé avec sobriété et intégré dans une stratégie de transition globale. « Se contenter de ce seul levier serait une erreur ; l’urgence est d’investir dans des efforts de décarbonation et d’économies de ressources bien plus profonds. Il s’agit de choisir le juste niveau de technologie au service d’un besoin réel, et non l’inverse », a souligné Erwann Fangeat, coordinateur technique de l’étude à l’Ademe.
Et la pertinence de solutions d’IA générative pour la transition écologique ?
Alors que l’intelligence artificielle générative est au centre de l’actualité, elle n’a pas fait l’objet d’un cas d’usage dans le cadre de cette phase de l’étude « IT4Green ». Cette absence s’explique par deux facteurs principaux. L’IA générative est une technologie très récente, et son déploiement ainsi que son impact sont encore trop neufs pour disposer de la quantité et de la robustesse des données nécessaires à une évaluation environnementale objective et complète. Deuxièmement, parce qu’il n’existe aujourd’hui que très peu de cas d’usage d’IA générative visant directement des réductions d’impact environnemental directes et significatives qui pourraient être mesurées et attribuées avec certitude à la solution numérique.
Alors que l’intelligence artificielle générative est au centre de l’actualité, elle n’a pas fait l’objet d’un cas d’usage dans le cadre de cette phase de l’étude « IT4Green ». Cette absence s’explique par deux facteurs principaux. L’IA générative est une technologie très récente, et son déploiement ainsi que son impact sont encore trop neufs pour disposer de la quantité et de la robustesse des données nécessaires à une évaluation environnementale objective et complète. Deuxièmement, parce qu’il n’existe aujourd’hui que très peu de cas d’usage d’IA générative visant directement des réductions d’impact environnemental directes et significatives qui pourraient être mesurées et attribuées avec certitude à la solution numérique.