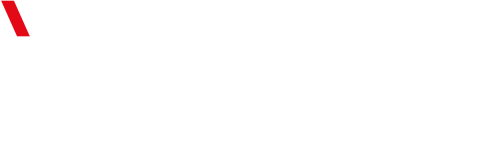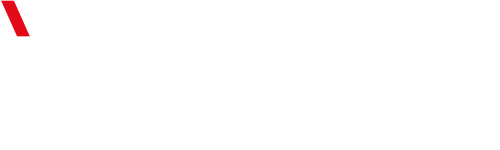Exigences de performance vs limites des batteries
Les systèmes opérationnels électriques doivent faire face à des applications haute puissance à service continu qui mettent les capacités des technologies de batterie actuelles à rude épreuve. Les machines compactes, telles que les mini-pelles et les petites chargeuses à roues, peuvent fonctionner efficacement avec une batterie lithium-ion. Cependant, ce n’est pas le cas des machines de moyen tonnage et des engins lourds. Leurs cycles de service exigeants, leurs durées de service à rallonge et leurs charges hydrauliques conséquentes nécessitent des niveaux de puissance difficiles à atteindre uniquement avec des batteries. Même si la densité énergétique de la batterie s’améliore, l’écart entre l’énergie stockée et la puissance requise reste un obstacle majeur pour les équipements de gros tonnage.
PUBLICITÉ
La perte d’énergie est un problème caché qui complique encore davantage l’électrification. Sur le plan énergétique, les systèmes hydrauliques traditionnels entraînés par des moteurs à combustion interne sont notoirement inefficaces. Des études sur la consommation énergétique des machines ont montré que moins de 15 % de l’énergie du carburant sont convertis en force de travail utile. Le reste est perdu à cause de la friction, de l’étranglement par fluide et des inefficacités des composants.
Ces pertes, qui dans certains systèmes dépassent les 85 %, représentent un levier d’amélioration majeur pour les architectures électriques. Les systèmes électriques peuvent être optimisés plus précisément en fonction de la demande, ce qui permet d’appliquer l’énergie où et quand elle est nécessaire, sans le gaspillage inhérent aux situations où le MCI est en fonctionnement continu.
Stratégies de conception de systèmes pour l’électrification
Les concepteurs ont désormais à leur disposition différentes solutions pour électrifier les systèmes opérationnels. L’une des approches les plus largement adoptées est la pompe électro-hydraulique ou EHP. Dans les premières applications, des moteurs électriques à vitesse fixe étaient utilisés pour reproduire le fonctionnement des moteurs à combustion. Cette méthode simplifiait l’intégration, mais offrait des gains d’efficacité limités. Les solutions EHP actuelles s’appuient sur les principes de l’alimentation à la demande et sur la commande du moteur à vitesse variable pour fournir une pression hydraulique uniquement en cas de besoin. Cette stratégie réduit les pertes liées à l’inactivité, diminue la consommation d’énergie et prolonge la durée de vie de la batterie.
EHP ou EHA : choisir l’approche adéquate
Les actionneurs électro-hydrauliques, ou EHA, éliminent complètement le circuit hydraulique central pour offrir un rendement encore plus élevé. Ces systèmes utilisent de l’énergie électrique pour entraîner le mouvement directement au niveau de l’actionneur. Bien que plus complexes et plus coûteux que les EHP, les EHA offrent un meilleur contrôle, plus de modularité et des performances énergétiques supérieures. Pour de nombreux OEM, une approche hybride utilisant des EHP en tandem avec des distributeurs et des actionneurs fixes conventionnels peut permettre de trouver le bon équilibre entre performances, complexité d’intégration et coûts.
Gestion thermique des machines électriques
La gestion thermique est un autre facteur à considérer dans la stratégie d’électrification. Les moteurs diesel généraient une chaleur résiduelle considérable qui pouvait être redirigée vers les fluides hydrauliques chauds ou chauffer la cabine. Dans les machines électriques, les sources de chaleur incluent les batteries, les onduleurs, les moteurs et les contrôleurs, chacune présentant des seuils de température et des besoins de refroidissement distincts. La gestion de ces charges thermiques nécessite des systèmes de refroidissement intégrés capables de maintenir des températures optimales dans une vaste diversité de conditions de fonctionnement.
Exigences en matière de refroidissement spécifiques à la machine
La complexité de la conception thermique varie selon le type de machine. Une pelleteuse, par exemple, nécessite deux boucles de refroidissement distinctes. L’une refroidit la transmission électrique, tandis que l’autre refroidit le moteur et l’onduleur qui entraînent le système hydraulique. Les machines utilisées pour le forage de surface posent d’autres défis. Ces machines sont dotées de flèches hautes et le liquide de refroidissement doit être pompé jusqu’à huit ou dix mètres pour atteindre le moteur, ce qui suppose des exigences plus fortes en matière de pression et de contrôle. Les piles à combustible à hydrogène imposent leurs propres contraintes, notamment l’échappement d’air à haute température qui doit se faire loin des opérateurs et des autres composants de la machine.
Considérations relatives à la tension des systèmes de refroidissement
En matière de systèmes de refroidissement, les ingénieurs doivent également choisir entre des options basse et haute tension. Comparer les systèmes 24 volts et 600 volts conçus pour dissiper la même quantité de chaleur est une approche typique. Les systèmes haute tension offrent généralement un meilleur débit d’air et un meilleur rendement, mais ils nécessitent également un câblage, des mesures de sécurité et une isolation spécifiques. Les systèmes basse tension sont plus simples à mettre en œuvre et occupent généralement moins d’espace. Cependant, ils offrent des performances moindres, ce qui limite leur utilisation à des applications plus localisées. Chaque application nécessite une évaluation minutieuse des contraintes de taille, de la charge de refroidissement, des exigences de sécurité et de l’effort d’intégration.
Rôle de l’hydrogène dans les applications à usage intensif
Alors que les batteries restent la principale source d’alimentation pour les machines compactes et moyennes, l’hydrogène apparaît comme une solution prometteuse pour les équipements lourds. La technologie des cellules lithium-ion continue de s’améliorer. Cependant, la densité de puissance nécessaire pour faire fonctionner de grandes machines pendant un cycle de travail complet reste insuffisante sans charge fréquente. Dans les zones où le réseau électrique n’est pas disponible ou est déjà saturé, l’hydrogène constitue une autre voie pour des opérations libres d’émission.
MCI à hydrogène vs piles à combustible
Le secteur de la construction investit dans les technologies de l’hydrogène en suivant deux axes principaux. Tout d’abord, l’utilisation de l’hydrogène dans les moteurs à combustion interne modifiés est envisagée. Cette approche permet de conserver l’architecture hydraulique et la transmission de base des moteurs diesel, tout en remplaçant le carburant. Les émissions de carbone sont réduites à zéro, mais le stockage sur la machine est important, car l’hydrogène doit être maintenu sous haute pression.
Le deuxième axe, plus novateur, est la pile à combustible à hydrogène. Dans cette configuration, une pile à combustible fournit la puissance de sortie de base, tandis qu’une batterie lithium-ion compacte fournit un couple supplémentaire lors des pics de demande. Cette configuration reproduit les architectures électriques alimentées par batterie, mais offre une autonomie prolongée et un ravitaillement plus rapide. Les systèmes à pile à combustible sont déjà testés sur des pelleteuses, des chariots élévateurs et des tombereaux articulés. Cependant, l’infrastructure de distribution d’hydrogène limitée représente encore un goulot d’étranglement majeur pour une adoption généralisée. La construction de cette infrastructure est actuellement une proposition coûteuse, mais si la demande venait à croître, la situation pourrait changer.
La numérisation est la colonne vertébrale de l’électrification
Au-delà du matériel, les systèmes intelligents et la connectivité numérique jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la prise en charge des systèmes opérationnels électriques. De plus en plus, les équipements de construction modernes sont équipés de capteurs qui surveillent la pression, le couple, la température et les contraintes mécaniques en temps réel. Ces capteurs contribuent non seulement à un fonctionnement efficace de la machine, mais alimentent également les systèmes de maintenance prédictive en données afin de détecter de potentielles défaillances avant qu’elles ne se produisent.
Sécurité fonctionnelle et fonctionnement semi-autonome
Les systèmes équipés de capteurs sont également essentiels pour répondre aux nouvelles normes de sécurité fonctionnelle. Dans les machines électriques et semi-autonomes, les systèmes électroniques de freinage et de direction doivent détecter les problèmes et y répondre automatiquement afin d’éviter tout accident. Des technologies telles que la direction et le freinage à commande électrique permettent de se passer des conduites hydrauliques dans la cabine de l’opérateur et de les remplacer par des dispositifs d’entrée électroniques, ce qui améliore le contrôle et permet de bénéficier de fonctions d’assistance automatisées. Ces technologies prennent également en charge les opérations à distance et autonomes, qui suscitent de plus en plus d’intérêt dans des applications telles que l’exploitation minière, les carrières et le terrassement à grande échelle.
Des machines plus intelligentes grâce à des plateformes de commande personnalisées
Les affichages numériques, la connectivité cloud et les logiciels de commande personnalisables permettent aux OEM d’adapter le comportement de la machine à des applications spécifiques. Les plateformes telles que l’IQAN de Parker offrent aux ingénieurs les outils nécessaires pour concevoir, tester et déployer une logique de commande sophistiquée tout en respectant les exigences de sécurité et de performances. L’intégration des diagnostics dans le cloud réduit encore davantage les temps d’entretien et améliore la disponibilité, car les routines d’entretien peuvent être planifiées en fonction des conditions réelles de la machine plutôt qu’en fonction d’intervalles fixes.
Conclusion : une conception axée sur la performance, l’efficacité et la durabilité
En fin de compte, l’avenir des systèmes opérationnels électriques repose sur la conception holistique de systèmes. L’électrification prendra son essor quand ces systèmes fondamentaux auront fait leurs preuves et seront optimisés. Les véritables gains d’efficacité et de performances s’obtiennent à condition de repenser l’architecture de toute la machine, en intégrant des commandes intelligentes, en gérant intelligemment les systèmes thermiques et en sélectionnant la source d’énergie adaptée à chaque application. Qu’il s’agisse de batteries, de systèmes à hydrogène ou de systèmes hybrides, l’objectif est de fournir des machines plus propres, plus silencieuses et plus productives sans sacrifier les performances robustes qu’exige le travail sur les chantiers.
L’électrification est en train de redéfinir le paysage de la construction, et les concepteurs de systèmes et les ingénieurs vont jouer un rôle décisif pour guider cette transition. En adoptant les nouvelles technologies et en s’associant à des fournisseurs de solutions qui comprennent à la fois les défis et les opportunités, le secteur peut jeter les bases de chantiers plus propres et plus intelligents.