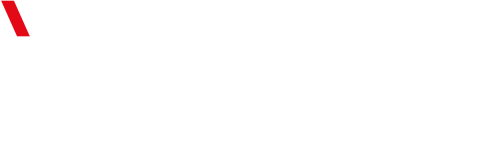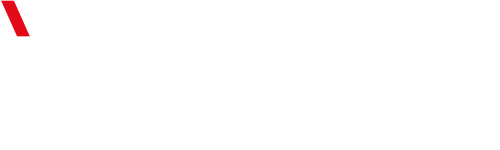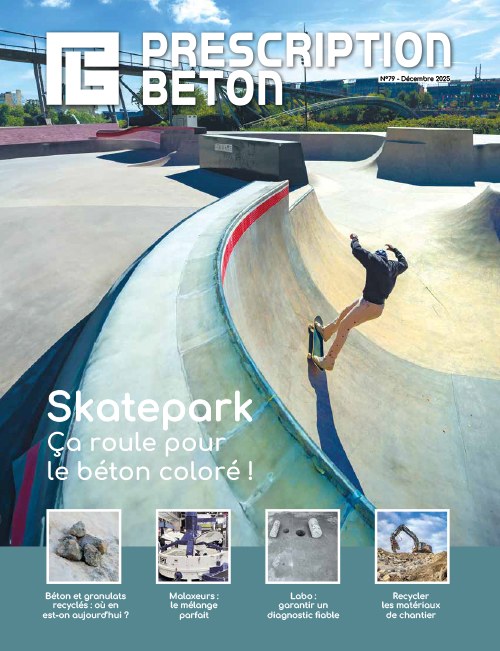Un jugement basé sur les quelque 16 PPP signés entre 2006 et 2014 par le ministère de la Justice pour la construction de bâtiments dédiés à la justice. En effet, les prisons, les palais de justice et les bâtiments administratifs de ce ministère représentent 16,4% du patrimoine immobilier de l’Etat alors que le budget de la justice pèse moins de 3% des crédits du gouvernement.
PUBLICITÉ
En France, selon l’Observatoire international des prisons (OIP), les partenariats public-privé auraient déjà généré une dette de 6 milliards d’euros, rappelle Le Parisien. Conviction encore renforcée par le fait qu’entre 2020 et 2036 les loyers des PPP pour les prisons risquent de représenter l’équivalent de 40% des crédits de l’immobilier pénitentiaire alors qu’ils ne représentent que 15% des places !
De fait, la Cour des comptes déplore que le recours aux PPP est motivé par "des considérations budgétaires à court terme" et plaide pour l’abandon pur et simple de ce type de financement. L’objectif : faire cesser "la fuite en avant".
Rappelons qu’un PPP est un moyen pour une collectivité de faire financer un bâtiment ou un ouvrage par un grand groupe de BTP à qui elle verse d’importants loyers, comprenant le plus souvent le coût de l’entretien et de la maintenance.
Alors que le gouvernement a annoncé son intention d’engager la construction de 15 000 places de prison sur 10 ans (soit 31 nouvelles prisons), nul doute que le "gâteau" risque de perdre sérieusement son attrait si le PPP est écarté.