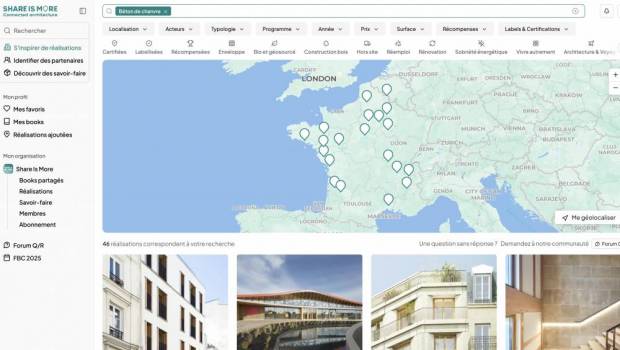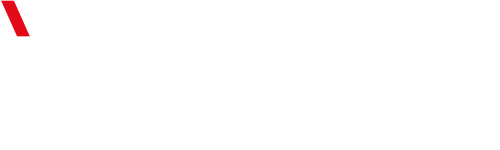L’assignation à résidence de 60 millions de citoyens a permis de réaffirmer leurs aspirations de proximité. Cette mise sous cloche a également laissé entrevoir des effets bénéfiques. La quiétude retrouvée au sein des grandes agglomérations a prolongé la remise en cause des voitures dans les centres urbains, et ainsi réaffirmé la nécessité de considérer mobilité et urbanisme de façon transverse.
PUBLICITÉ
Des espaces publics à repenser
Avec des villes pensées pour les voitures ces dernières décennies, l’emprise du « voiturbanisme » a peu à peu grignoté les trottoirs au point d’imposer ses propres besoins. Sacrifiés, les espaces piétons sont de nouveaux espaces publics à repenser, à valoriser et à se réapproprier. Ils constituent une opportunité pour replacer les besoins des habitants au centre du jeu, et répondre à leurs aspirations en matière d’écologie, de qualité de vie et de gestion du temps.
Repenser les espaces publics revient tout autant à s’interroger sur la dichotomie supposée (voire dépassée ?) entre le privé et le public. Est-ce qu’un « espace public » qui reçoit du public, doit-il être forcément définit comme tel ? A l’inverse, un espace strictement public, qui n’en reçoit pas, peut-il être privatisable ?
Pour impulser ces nouvelles dynamiques, les pieds d’immeuble constituent à ce titre de vrais espaces de réflexion quant à leur gestion (à la fois publique et privée) et de transition importante pour déployer des services, et répondre aux nouveaux usages de la ville.
Les « quartiers-villages », ou la ville du kilomètre
Parmi les besoins pointés durant cette crise, la recherche de proximité a réveillé de lointaines aspirations. Trouver une pharmacie, une boulangerie, une « agora » où rencontrer ses proches… Nous avons été nombreux à mesurer les bénéfices apportés par ces services durant le confinement. Les commerces, espaces dédiés au do it yourself via les makers, voire les jardins partagés sont des moteurs d’attractivité. Ils ont leur part à jouer pour revitaliser nos villes, devenir des lieux de rencontre et de développement de sociabilités, tout en contribuant localement à la création d’un nouveau cadre de vie.
Ces « quartiers-villages », où chacun doit pouvoir trouver des produits essentiels à moins de dix minutes de chez lui, ne pourront être gage de réussite que s’ils prennent en compte toutes les catégories de la population. Le développement du phénomène des makers en est un exemple : souvent affiliés à un mode de vie bohème, il renvoie avant tout à un vrai savoir-faire artisanal fait de récupération et de réparation. Vivier de talents et symboles de mixité sociale, ils peuvent être les fers lance d’une économie circulaire ancrée localement.
Repenser l’aménagement territorial, les innovations qui en découlent, les tester et les déployer en faveur de tous… Cette ville de demain telle que nous pouvons l’imaginer dans un monde post-crise se doit d’être pensée pour tous, et au service des catégories les plus modestes.
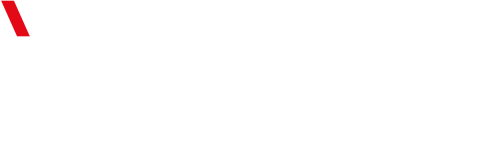










![[Tribune] : « Les quartiers-villages, une réponse aux exigences de proximité et de mixité sociale »](/e-docs/00/01/FE/73/tribune-les-quartiersvillages-une-reponse-aux-exigences-proximite-mixite-sociale_620x350.jpg)